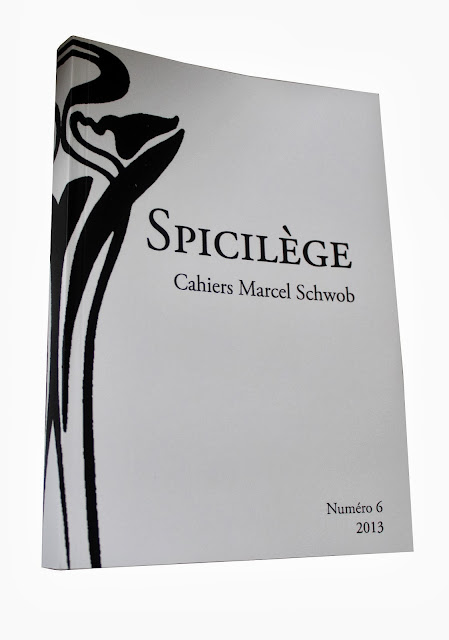|
| Cour dans un quartier pauvre |
Gustave Geffroy écrit dans la préface au Pietro Longhi d'Octave Uzanne publié en 1924 : « [...] Octave Uzanne a fait revivre la Venise du XVIIIe siècle, en réclamant pour elle une place glorieuse malgré le verdict de décadence prononcé contre son agonie en carnaval, en déguisement et en musique. Il a brodé sur cette trame les pages chatoyantes, éblouissantes, vivantes, que l'on pouvait attendre de lui, Uzanne, dont le cosmopolitisme a choisi Venise comme seconde patrie. A le lire, on croirait qu'il a vécu, qu'il a regardé peindre Guardi et conversé avec Casanova, qu'il s'est mêlé à la foule des masques blancs, des manteaux noirs, des tricornes galonnés, de toutes ces figures qui sont à peu près revenues à la mode dans le Paris d'aujourd'hui [...] »
« La Venise du XVIIIe siècle est un merveilleux enchantement, écrit Uzanne en tête du second chapitre de son Pietro Longhi, nous l'aimons mieux peut-être dans la dépréciation de sa longue puissance mercantile et dans la diminution de sa souveraineté dictatoriale que nous ne l'admirions à l'apogée même de ses fabuleux succès maritimes. Il nous semble qu'elle s'offre à nous plus féminine dans sa faiblesse et son anémie que dans sa pléthore et l'exubérance de sa santé congestible. Tout nous plait d'avantage en elle, à l'heure où ses grâces efféminées la font plus indolente et plus accueillante à la fois, moins sévère dans sa moralité et mieux accessible aux plaisirs, aux fêtes, aux mascarades, aux spectacles, aux aventures, aux intrigues et galanteries de toute nature. N'est-elle pas la Cité, nid d'amour par excellence, la ville où les libres parties ailées de l'imagination romanesque peuvent aisément se développer en envols d'idéal se donnant essor dans un cadre essentiellement de fantaisie et même d'extravagance. »
 |
| Palais sur les bords du canal San Marina |
En quelle année Octave Uzanne découvrit-il Venise ? Nous n'avons pas de réponse précise à cette question pour le moment. Il semblerait qu'il s'y rendit dès le début des années 1880 et sans doute même dès les années de jeunesse, entre 1872 et 1875, alors qu'il parcourt une grande partie de l'Europe centrale. Il s'y fait photographier par Vinnelli à la fin des années 1880. Dans une lettre qu'il adresse à un ami, il écrit le 18 mars 1885 : « Peut-être vais-je boire un peu d’air vénitien à la fin de mai – je suis affolé de Venise. » C'est assez dire tout l'amour qu'il portait déjà à la cité des Doges. Il signe le 18 avril 1899 pour l'Echo de Paris une causerie caustique intitulée La saison à Venise (*).
En 1907 Uzanne publie Les deux Canaletto, dans laquelle il peint longuement la Venise souveraine.
Le 10 avril 1898 il écrivait à propos de la disparition de Charles Yriarte et son amour pour Venise (**) : « C'est que Charles Yriarte fut un français vraiment amoureux de Venise, un des derniers familiers des Procuraties de San Marco et du petit café Florian. A chaque nouvelle excursion vers la divine cité des Doges, alors que je m'acagnardais dans les flâneries de la piazza, les amis que je croisais, les commandatori et cavalieri, dont la vie s'écoule si douce, si berceuse, si exempte de fièvre et de tracas [...] Nous nous retrouvions chez Florian avec tous les casanovistes, le professeur d'Ancona, de Vérone, le commandeur Barozzi, le chevalier Stefani, Molmenti, le de Goncourt vénitien, et quelques autres qui tous flambaient d'amour pour cette inoubliable Venise, la ville-femme qu'on n'oublie jamais quand on l'a possédée ; et toujours cette phrase de l'un des coins de ce café Florian où l'on consommait jamais, où l'on causait sans fin, m'arrivait interrogatrice dès qu'on connaissait ma qualité de Français : Pensez-vous qu'Yriarte viendra bientôt cette année ! Venise ... et Yriarte communiaient quelque peu dans mes souvenirs. - Le doyen des Vénitiens, c'est aujourd'hui Ziem qui le fut si peu en réalité, car il convient de révéler qu'il a peint toutes ses plus glorieuses Venises à Montmartre, dans les visions des splendides soleils couchants de la rue Lepic. »
 |
| Vue du canal San Marina |
Quelques lettres d'Octave Uzanne nous révèlent quelques uns de ses déplacements dans la cité des Doges. Il écrit depuis Venise à son frère Joseph le 17 avril 1899 ; il doit s'y rendre peu de temps après le 19 juin 1906. Octave Uzanne donne quelques conseils à son frère qui souhaite s'y rendre en 1909 : « J’espère bien que tu sauras voir Venise, qu’il faut voir seul, où il faut se perdre, s’égarer, se retrouver, aller au hasard dans les moindres ruelles et ne manquer aucune église, surtout celle de St Sebastiano, sur la Giudecca, où est enterré Paolo Veronese. Il y a une centaine d’églises et de chapelles et des maisons à voir à l’infini. Les étrangers voient mal et peu Venise – Il y faut marcher beaucoup et ne rien négliger – en dehors des Frari et de San Giovanni et Paolo, que de petites chapelles ! celle des Esclavons où sont surtout les peintures de ce surprenant Carpaccio – entre partout, ne néglige rien. » (Saint-Cloud, fin 1909).
On peut supposer qu'Octave Uzanne se rendait à Venise régulièrement, peut-être tous les deux ans voire tous les ans ? Nous ne savons pas avec précisions. Sans doute d'autres témoignages peuvent-ils encore être découverts sur ces excursions solitaires dans la belle Venise.
Nous venons de découvrir dans le numéro de décembre 1895 de la revue Le Monde Moderne un article intitulé Coins de Venise et signé Fridolin. Après lecture attentive de cet article nous sommes convaincu qu'il est de la plume d'Octave Uzanne. Uzanne collabore à cette nouvelle revue dirigée par son ancien imprimeur du Livre (1880-1889), Albert Quantin. Uzanne signe plusieurs articles pour cette revue et ce dès le premier semestre de la même année 1895. A y regarder de plus près, plusieurs articles signés de pseudonymes divers variés semblent sortir tout droit de la plume aiguisée et curieuse d'Octave Uzanne. Nous reviendrons bientôt sur d'autres articles qu'on lui attribue.
Concernant cet article sur Venise, tout s'y trouve pour répondre positivement à la paternité Uzannienne : vocabulaire parfois désuet, comme par exemple ruissel pour ruisseau ; néologisme, avec l'eau qui floufloute ; et puis il y surtout ce style inimitable que des heures et des heures de lecture nous empêche de passer à côté sans le remarquer dès les premières lignes. Il y a bien évidemment le fond de l'article : Uzanne nous entraîne dans les ruelles pauvres d'une Venise fantasmée replacée dans le XVIIIe siècle flamboyant de fêtes et de festins. La femme patricienne y tient bien évidemment grand place avec toute la cérémonie décomposée de sa toilette. L'auteur indique qu'il est déjà venu à Venise plusieurs fois. Sans doute cet article publié en décembre 1895 fait-il suite à un séjour proche (printemps 1895 ?), nous ne savons pas.
Octave Uzanne donna le virus à son ami Jean Lorrain qui lui écrit le 1er octobre 1898 : « Si j'aime Venise...mon cher ami ? Mais c'est à dire que c'est la Ville élue, que c'est ma Ville. [...] Venise est la plus intense, la plus grande émotion de ma vie. [...] »
Bertrand Hugonnard-Roche
* *
*
Coins de Venise
par FRIDOLIN [Octave Uzanne]
 |
| Canale di Santa Maria Mater Domini |
Je ne veux vous parler ni de Saint-Marc, ni du Campanile, ni du palais des Doges, ni de la Piazztta, ni de la tour où les deux Jacquemarts frappent les heures sur une cloche, ni même du pont des Soupirs, du Rialto et du Grand Canal. Il est une autre Venise que celles qu'indiquent les guides de voyage ou que prônent les ciceroni à vingt francs par jour. Et cette Venise là, qui vaut bien l'autre, il faut être seul pour la voir, pour la connaître et pour l'aimer. Alors on s'acoquine et quand, par la suite, le souvenir rêveur se reporte vers la magie de l'Adriatique, baignée de soleil, vers le décor féerique de cette place, bordée de palais, que Napoléon nommait la plus belle salle du monde, ou vers les promenades délicieuses sur la lagune, au scintillement des étoiles qui paraissent, à Venise, plus grandes et plus vives qu'ailleurs, un coin de douce mélancolie, de charme berçant, de farniente voluptueux vous apparaît comme un repos, à l'évocation des canaux étroits et des ruelles qui les bordent par places, le tout s'entre-croisant, s'emmêlant et s'enchevêtrant avec un grand silence et une grande ombre planant sur l'eau claire qui floufloute aux pieux, aux pali, peints aux couleurs des riverains.
Maisons tristes et pauvres églises perdues au milieu de bâtiments gris entassés les uns sur les autres, diront les chagrins. Possible, mais que cette pauvreté à de Poésie ! Seulement, - il faut bien le dire, - ce n'est pas par ces canaux déshérités qu'il faut faire son entrée à Venise, surtout lorsqu'on y vient pour la première fois. L'arrivée par le Ponte sulla laguna, qui relie la reine de l'Adriatique à la terre ferme, est déjà suffisamment navrante pour qu'on n'y joigne pas l'impression des quartiers sans mouvement.
C'est pourtant ce que j'essayai, la deuxième ou troisième fois que je fus à Venise. Au lieu de me jeter tout droit dans le Grand Canal, qui n'est séparé de la gare que par un trottoir de quelques mètres, je m'enfonçai dans une ruelle, puis dans une autre, puis dans une troisième, au bout de laquelle je me heurtai à la porte d'un palais qui tombait à pic dans l'eau. Je revins sur mes pas, pris à gauche, puis à droite, me retrouvai dans les mêmes ruelles, et finalement entrai dans une maison, pour demander mon chemin.
Pauvre demeure, misérable d'aspect, mais avec un grand air cependant, au dehors comme au dedans. Au fond, la cour, baignée de soleil, commune à toute une enfilade de maisons, avec, à l'une d'elles, une avalanche de vigne vierge dégringolant du troisième étage. La verdure à Venise, quel rêve ! Il fallait avoir perdu sa route et être entré dans ce réduit de briques effritées pour jouir de ce spectacle.
 |
| Rio Bernardo |
En sortant de cet Eden, et muni d'indications aussi nombreuses qu'obscures, je ne tardai pas, après de nombreux zigzags, à me retrouver, comme auparavant, devant la porte d'un nouveau palais qui me barrait le chemin. Mais, au moins, cette fois, je m'y reconnus. J'étais sur les bords du canal Santa Marina, qui se jette dans le Grand Canal, proche le théâtre Malibran.
Ah ! l'aimable palais. J'avais passé cent fois devant lui sans le remarquer, car il n'a pas d'histoire, écrite du moins, et ne figure pas dans les guides. Et maintenant, je l'admirais. Toute souriante m'apparaissait sa porte, et je me figurai ce qu'il devait être, au temps de la Venise épicurienne, qui fut la vraie, la seule Venise.
A l'étage noble se tient, dès le matin, le seigneur du lieu, portant la robe de drap noir, fourrée d'hermine, agrafée sous le cou, et laissant voir un col de chemise bien arrangé. Les manches bouffantes sont énormes et semblent une paire d'ailes développées. « Plus la dignité est grande, plus la manche est large » a dit le président de Brosses. Et, le modèle des touristes qui savent voir et conter, d'ajouter : « Elle n'est pas inutile pour mettre la provision de boucherie, avec une salade dans le grand bonnet. » Le fait est qu'il est monumental, ce bonnet, noir aussi, comme l'ordonnaient les lois somptuaires, mais ceint d'un voile d'étoffe précieuse, ou de guirlandes de petites perles de verre, avec quelques médailles ou pierre fines au galon.
Ce patricien reçoit ses amis et cause avec eux, durant d'interminables heures, de sujets futiles le plus souvent, car on sait bien qu'à Venise, à part une ou deux conjurations célèbres, on n'a jamais conspiré que dans les opéras-comiques. Autour de ces vénérables seigneurs, auxquels des pages ne cessent de verser les vins de Chypre et de Samos, la jeunesse, parée de pourpoints de soie, de satin ou de canevas, avec des boutons d'or, et, aux coutures, des passements et des dentelles, la chevelure, longue et bouclée, descendant sur les épaules, et portant à l'arrière de la tête le gracieux fez rouge ou noir, joue à divers jeux, fait des armes ou récite des vers, en s'accompagnant sur la mandoline. Le moment va venir où les femmes et les filles se joindront à cette aimable compagnie ; mais l'heure de ce gracieux appoint n'a pas encore sonné. La Vénitienne est à sa toilette, et sa toilette dure toute la matinée, sinon toute la journée.
C'est d'abord la teinture des cheveux, quotidienne, et qui demande de longues heures. La centaurée, la gomme adragante, le savon sec et plusieurs autres produits de l'Orient et des Indes formaient la base du mélange adopté ; puis la patiente se transportait sur la terrasse du palais pour faire sécher au grand soleil sa chevelure détressée. Entourée de ses femmes, et souvent de danseuses, qui vivaient alors dans l'intimité des patriciennes, - c'était l'habitude, - la noble dame s'asseyait au plus vif des rayons de Phébus, vêtue de toile légère, la tête couverte, en guise de chapeau, d'un cercle de paille fine, et se mouillant, par instants, la tête avec une petite éponge attachée au bout d'un fuseau.
L'habillement suivait, long aussi, car le choix des robes et des ornements formait le sujet de savantes méditations. Puis c'était le tour des bijoux, des bagues en turquoises surtout, et des bracelets d'un travail exquis, ainsi que des dentelles et des éventails dont toute patricienne, digne de ce nom, entretenait tout un musée. Les parfums venaient ensuite, précieuses gouttes des sérails orientaux qui, au mérite d'embaumer délicieusement, joignaient le privilège d'entretenir une atmosphère de fraîcheur autour de la femme qui s'en servait.
Alors commençait la tâche ardue de la coiffeuse ; car ce n'était pas une petite affaire que l'édification monumentale de la chevelure d'une élégante Vénitienne. Il y eut un moment, vers 1550, à ce que nous apprennent les chroniques, où les dames portèrent leurs boucles tordues en forme de cornes. C'était, comme on peut le penser, fort laid, mais le voile, le zondoletto, comme on le nommait, immuable à travers les fluctuations de la mode, atténuait jusqu'au ridicule de cette coiffure. Il couvrait la tête, se roulait en serpentant autour du col, et venait se nouer à la taille, laissant flotter ses deux bouts par derrière. De l'avis de tous, cet ornement était du plus gracieux effet.
Maintenant la toilette est achevée ; les valets ont corné l'eau pour annoncer le repas ; les musiciens et les acteurs, pour les entremets, ont pris leur place ; et la dame du lieu se dispose à se rendre parmi ses invités. Un détail encore ! La dame chausse donc ses calcagnetti, montés sur des talons si hauts qu'ils atteignent parfois un demi-mètre, ce qui la fait paraître une géante et la force à s'appuyer sur deux de ses femmes pour marcher.
Et pourtant, il faut qu'elle marche, plus que toute autre, même chez elle, même dans son palais, car l'usage veut, pour ne citer qu'un exemple de ces périgrinations intimes, que les convives changent de table à chaque service. La chère est délicate. Comme les anciens Romains, les citoyens de la sérénissime république mettaient le monde entier au service de leur gourmandise, et, comme eux également, ils s'égayaient, en savourant des mets exquis, aux bouffonneries des pitres, qui faisaient assaut de grimaces, et aux divertissements plus variés des masques, des danseurs et des musiciens.
Ensuite, on passait au ridotto, au réduit, banque de jeu, tripot familier, plaisir recherché sur tous. Les besants d'or couvraient la table incrustée de nacre, venue d'Hanoï tout droit. Les grands seigneurs, tous marchands, jouaient, sur un coup de dés, leurs felouques, contenant et contenu. C'était la Bourse de ce temps-là. Et l'on se ruinait de palais à palais, entre le dîner et le souper, avec l'espoir, rarement déçu, de se rattraper aux bougies.
Souvent, on allait en promenade ; mais pendant la belle saison seulement, bien définie : - du deuxième lundi de Pâques jusqu'en septembre, passé le premier quartier de la lune. C'était pendant ce temps que se passaient les grandes fêtes, les corti bandite, magnifiques réjouissances, durant lesquelles se succédaient, par tout Venise, sous la pompe et l'éclat des tentures, les chants et les danses, les tournois, les festins et les fêtes populaires. Le plus grand plaisir de cette foule brillante était - et la mode s'en est conservée - de se rendre à terre et d'y organiser des cavalcades. On allait manger la polenta dans les champs, sur l'herbe, loin des lagunes. Vrais convois de fous, d'écoliers en vacances, de seigneurs en délire. On partait en litière, à cheval, à dos de mulet, à âne. L'un portait le chaudron, un autre la poêle, un troisième le paquet de farine de maïs, et les suivants se partageaient le panier aux vins, le panier à eau et le filet garni de petits oiseaux qui sont l'âme la plus exquise des bouillies. Sous un arbre on se groupait ; on faisait sa cuisine soi-même ; le feu flambait joyeusement, et les mauviettes, grillées au parmesan, répandaient une alléchante odeur. Le repas suivait, joyeux et bruyant ; puis on dansait jusqu'à l'heure de regagner la ville lacustre, où d'autres délassements attendaient la folle compagnie.
 |
| Vue prise du pont Della Veneta Marina |
Je pensais à tout cela en regardant cette porte qui me barrait le chemin ; et, l'imagination aidant, il me semblait qu'elle s'ouvrait à tout moment pour livrer passage à tout un monde de brocarts d'or et de dentelles. Le soleil mettait un ton chaud à ce vieux palais, et l'eau, à ses pieds, coulait claire et transparente, comme le ruissel au sortir de la source.
Cette eau de Venise, c'est bien le miroir d'une coquette, et Venise est la reine des coquettes. Ses palais et ses églises s'y mirent avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et ses maisons les plus grises s'y reflètent en teintes roses, du plus tendre effet. Oui, l'eau est bien l'âme de Venise, et les ruelles ne sont faites que pour trouver l'eau plus vite.
A l'eau donc !... Poppe !... Poppe !
C'est le cri qu'on envoie quand on veut avoir une gondole. Aussitôt, une barquette, que je n'ai pas vue venir, accoste à l'escalier qui descend au canal. C'est bien là l'équipage qu'il me faut, moins décoratif que la gondole à la proue dentelée, mais plus aérée et plus commode pour se diriger à travers les méandres des petits canaux. Un second palais, vrai bijou oriental, succède au premier ; puis c'est, à chaque tournant, surprise nouvelle, décor nouveau.
- Già è ! crie mon batelier, en signe d'avertissement, au moment de passer d'un canal à un autre. - Sia premi ! (à droite !) Sia stali ! (à gauche !) Sia di lungo ! (va droit !)
Et, avec une dextérité sans pareille, il pare, il vire, et, sans jamais accrocher une barque ni un pieu, il file, en psalmodiant les octaves du Tasse. Cela vaut bien les chanteurs spéciaux, les pittori e gondolieri, qu'on engage à prix d'argent, pour sanctifier les nuits étoilées ; de même que, décidément, la barquette est mille fois plus agréable que la gondole, chantée par les poètes, « douce », cependant, « comme le berceau, secrète comme la tombe ».
 |
Ponte dei Baratteri
(sous la neige) |
Un canal tout en palais, c'est le canale di Santa Maria mater Domini. Il débouche dans le grand canal : c'est une rue aristocratique, une rue mondaine. Il en est de même, en partie tout au moins, du rio Bernardo. Au ponte dei Baratteri, que, par une coquetterie qui, pour beaucoup, peut sembler une gageure nous avons - la photographie faisant preuve - représenté par la neige, - la neige à Venise !... c'est toute une orgie de pierres sculptées, de balcons fouillés comme des joyaux, de colonnades en marbres précieux. Merveilleux décor, auquel le pont même donne un attrait de plus. Il semble, malgré la neige, qu'on y va voir passer le doge, dans un jour de solennité, se montrant sous son ombrelle de drap d'or, précédé de pennons de taffetas doré, avec, à ses côtés, des pages soufflant dans des trompes d'argent. Une foule de gentils-hommes et de prélats lui font cortège, et le peuple ferme la marche.
Dans d'autres canaux, on passe derrière ces palais somptueux, et le spectacle n'en est pas moins attrayant.
 |
| Le Palais Albrizzi |
Eh ! que disions-nous donc... qu'il n'y avait pas de verdure à Venise ? Mais c'est une forêt, ou mieux un de ces vieux beaux jardins du faubourg Saint-Germain, que nous avons sous les yeux au palais Albrizzi. Quelle flore ! quelle végétation ! Et il en est ainsi en cent autres endroits de Venise, - pas sur le grand canal, par exemple.
Sur la rive nord de cette voie dorée, via aurea, sa rivale, les canaux ont, en approchant de la mer surtout, moins grand air que ceux que nous venons de parcourir, mais ils n'en font pas moins bonne figure. Et puis, on y vit de la vie populaire, qui a ses curiosités et sa couleur bien particulière. Le vénitien, à quelque rang qu'il appartienne, est tout homme de plaisir ; il ne vit que de plaisirs ; il va, comme on dit, «à la chasse au plaisir ». Le moindre pêcheur, le moindre gondolier en prend sa bonne part. De la desserte patricienne lui tombent de bons morceaux ; et quand le spectacle ne lui est pas offert par les grands, il se le donne à lui-même. Il faut les voir, les joyeux drilles de Venise, jouant au coup de poing sur les ponts sans parapet. Partagés en deux camps, ils se précipitent, à un signal donné, les uns contre les autres, et les horizons de pleuvoir, et les échines de plier, et les corps de s'abattre lourdement dans l'eau, pour la plus grande hilarité des assistants.
 |
| Canal Saint-Barnabé |
Le canal Saint-Barnabé débouche dans le grand canal, et brusquement nous avons sous les yeux le tableau magique du palais des doges, de Saint-Marc, du Campanile. Spectacle unique au monde, et auquel nous a délicieusement préparé notre matinée dans la Venise de l'eau claire et des arbres touffus. Nous ne l'oublierons de longtemps, ce spectacle ; mais chaque chose a son moment. Les cloches sonnent ; le canon tonne ; il est midi.
- Poppe, hâte-toi, afin que nous arrivions à temps sur la place Saint-Marc pour donner à manger aux pigeons qui déjà volètent de tous côtés, autour de nous.
FRIDOLIN
[Octave Uzanne]
(*) 18 avril 1899 - La saison à Venise. - Elle bat son plein, la Saison vénitienne ; la ville des Doges vit sous l’œil des Barbares. Les caravanes des voyages économiques y affluent ; elles descendent par les monts du Tyrol ou par le Gothard, elles débarquent, venant de Fiume ou de Trieste, et, à l'heure des trains et des bateaux, les canaux sont sillonnés de gondoles chargées de malles et de touristes allemands, anglais, suisses, russes, voire quelques Français et Américains, porteurs du rouge Baedeker qui dicte et réglemente leur enthousiasme. Les hôtels sont actuellement envahis par des colonies de bourgeois de toutes provenances et de même laideur ; ce sont des familles de shopkeepers des comtés d'Angleterre, des Her Professoren à lunettes d'universités rhénanes, des Tyroliens au feutre vert empenné, des petits Suisses inoffensifs et surtout des dames pesantes, obèses, congestionnées, chargées d'antiques camées, désespérément souriantes ; des vieilles filles aux ménopauses accomplies, qui viennent dans cet incomparable reliquaire d'art, dans cette souveraine ville de marbre constellée comme un firmament de souvenirs romanesques, chercher un frisson d'idéal, se phosphoriser l'imagination à la ressouvenance des barcarolles, des photographies clairdelunées, des sérénades et des décors d'opéras-comiques les plus trivials.
Tout cela passe, la gueule ouverte en O, l'oeil incompréhensif à ce qui n'est pas Baedekerie ; tout ce monde de nourriture en des salles de banquets décorées par des Bouguereau italiens ; tous ces êtres enregistrés à prix fixe s'offrent le supplément d'être photographiés en gondole, sinon donnant la pâture aux colombes de Saint-Marc ; heureusement la plupart ont une égale horreur des églises et des musées ; ils agacent plus qu'ils n'encombrent. Venise est devenue la Mecque sentimentale des indigents de la vie pittoresque.
Combien métamorphosée déjà, la ville de Casanova, de d'Aponte, de Goldoni ! Les vieux cabarets où l'on s'attardait à faire rôtir des cigares Virginia sur la flamme des chandelles, où l'on mangeait des poulpes de lagune amorphes comme des dessins d'Odilon Redon, où les flasques de Chianti étaient montées ainsi que des pièces de siège sur des affûts pivotant sur la vasque des verres, sont rajeunis, blanchis, fleuris, anglicisés. On dîne aux Quadri, au Capello nero, au Vapore, au Cavaletto, par petites tables décorées, sous la lueur rose des abat-jour, comme au Savoy, au Ritz, ou au café de Paris.
En une même promenade mi-partie sur la lagune, le grand canal et sur la Piazza, je croise l'impératrice Frédéric sortant de l'albergo Britannia avec lady Layard, l'archiduchesse Stéphanie, la princesse de Galles et sa fille Maud, dont le yacht Osborne est ancré près de Saint-Georgio Maggiore ; la jolie contesse Merosini, la reine de Venise il y a dix ans, la comtesse Albrizzi aussi inattaquable par l'âge que les stucs renommés de son palais ; Molmenti, l'historien de la vie privée vénitienne jusqu'à la chute de la République ; don Carlos, suivi de son chien et de son policier et qui grisonne dans l'inaction en son palais Loredano ; le peintre Fra Giacomo qui signe des vues de Saint-Marc qu'on jurerait de Besnard ; enfin le vieux commandeur Nicolo Barozzi, notre ami, le dernier de la vieille école de politesse, les cheveux bouclés à la Rossini, la moustache en pointe, la canne éloquente, semant les salutations affables sur son passage : « Servitor suo comte, ou : Bonjourno, carissimo ! Complimenti, signor ! » avec des tours de reins, des ronds de bras dont l'élasticité semble devoir se perdre.
Malgré l’écœurement des étrangers souillant cette cité d'indolence et de rêve, je me replonge dans Venise avec amour, avec passion et, dans cette coulée d'êtres qui torrentueusement se précipite et s'endigue dans les rues étroites de la Merceria, je retrouve toutes mes ivresses de naguère. Je sens que je n'échapperai pas à la magie de cette ville douairière qu'on retrouve, qui vous possède et qui vous endolorit à la seule pensée de la devoir quitter. [article signé : OCTAVE UZANNE (La Cagoule)].
(**) Echo de Paris du vendredi 15 avril 1898, repris dans Visions de notre heure, pp. 110-111.